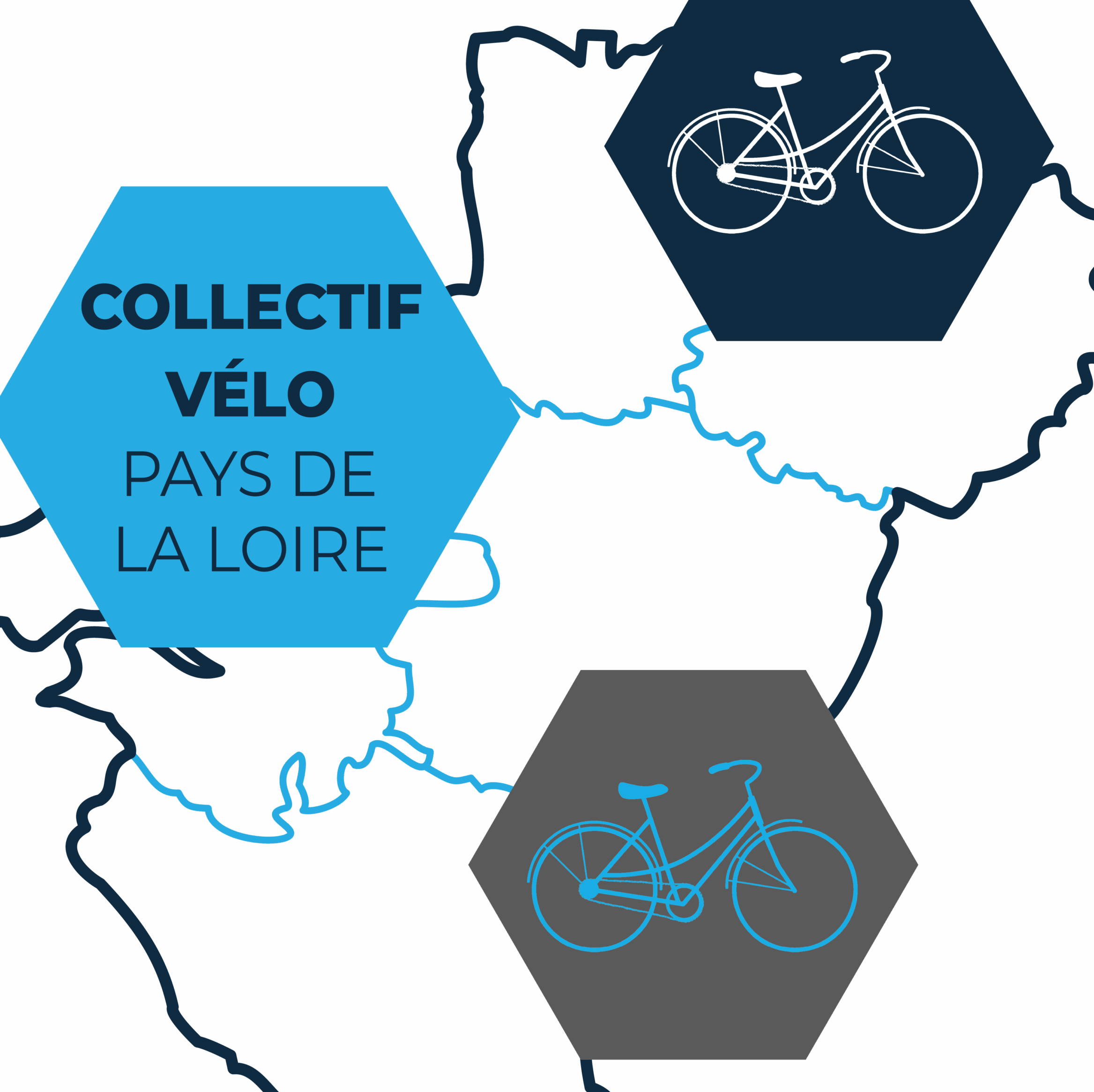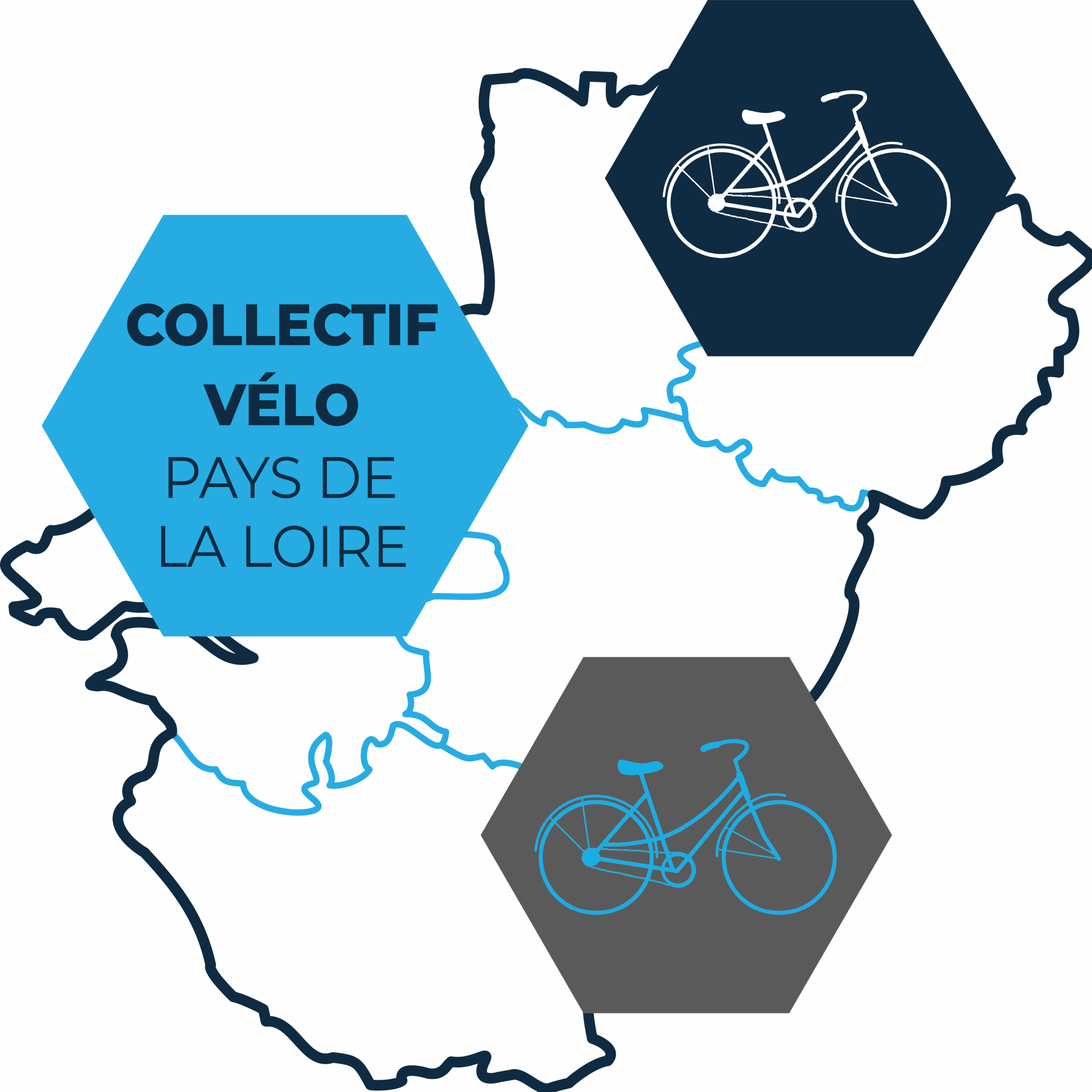1. Observatoire des inégalités autour du vélo et des déplacements en Pays de la Loire
Le rapport 2021 du Secours Catholique « Territoires ruraux en panne de mobilité », l’étude « Mobilité des Jeunes en zone rurale » du Laboratoire des mobilités inclusives https://www.mobiliteinclusive.com/etude-mobilite-des-jeunes-en-zone-rurale/ ainsi que la rapport des mobilités au quotidien de Wimoov apportent des éclairages essentiels pour comprendre les enjeux autour du développement du vélo de manière égale sur l’ensemble des territoires, y compris les plus ruraux, ainsi que sur les contraintes qui pèsent globalement sur les déplacements, en France et en Pays de la Loire en particulier.
Ces inégalités sont à étudier avec une attention toute particulière au regard des enjeux sur la question du genre, et du fait de résider en QPV, puisque l »inégalité d’accès à la possibilité de faire le choix du vélo est d’autant plus forte au regard de ces critères.
En 2024, 15 millions de personnes en France sont en précarité mobilité. En Pays de la Loire, il s’agit de 16% de la population qui est considérée à risque, soient 608 000 personnes. La précarité mobilité recouvre 3 dimensions :
-
- La précarité carburant (faibles ressources financières, restrictions de l’usage de la voiture et dépenses de carburant élevées) : 8.5% de la population ligérienne.
- La vulnérabilité de mobilité (faibles ressources financières, mauvais ajustement spatial ou distances parcourues élevées, absence d’alternatives à la voiture, véhicules à faible rendement) : 8% de la population.
- La dépendance à la voiture (dépenses de carburant élevées, mauvais ajustement spatial ou distances parcourues élevées, absence d’alternatives à la voiture) : 9% de la population.
- La dépendance à la voiture se traduit notamment par l’absence ou la faiblesse des alternatives à la voiture :
- Selon UFC que Choisir, la part de population à plus de 10 minutes à pied d’un arrêt de transport en commun est de 19% dans le 44, 21% dans le 49, 31% dans le 53 et le 72 et 44% dans le 85 (17% au national). Le baromètre Wimoov souligne également que les habitants des Pays de la Loire ont globalement moins accès aux services et modes de transport en proximité, à l’exception des aires de covoiturage.
- On observe que près de 15 % des personnes résidant en Pays de la Loire ne disposent d’aucun service de mobilité à proximité de chez eux ( VLS, TC, TAD, TAXIs, Voitures libres service, aires de covoiturage, et trottinettes en libre-service inclus).
- Selon le laboratoire des mobilités inclusives, 53 % des jeunes ruraux déclarent être mal desservis par le réseau de bus, contre seulement 14 % chez les jeunes urbains. Les jeunes ruraux sont 69 % à dépendre de la voiture quotidiennement, contre 31 % des urbains.
- L’enjeu se situe également dans un besoin de réaliser des distances plus grandes, dans des territoires avec moins d’alternatives à la voiture, renforçant la dépendance, les inégalités et l’exclusion des enjeux de transition écologique :
- En 2021, selon l’Insee, plus de 21 000 communes ne disposent plus d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles, contre 25 % en 1980.
- En 2019, chaque habitant des territoires ruraux a parcouru au quotidien 33 % de distances de plus que la moyenne des Français.
- Les jeunes ruraux de 18 ans et plus issus de communes très peu denses passent en moyenne 2 h 37 dans les transports chaque jour. Soit 42 minutes de plus que pour les jeunes urbains majeurs (1 h 55) (Laboratoire des mobilités inclusives). Cela se traduit très concrètement par un budget transport qui explose : le budget moyen pour les transports d’un jeune rural s’élève à 528 euros par mois versus 307 euros pour les jeunes urbains du même âge.
Cette précarité a des conséquences immédiates pour les personnes concernées et les territoires :
- 18% des personnes habitants en Pays de la Loire ont renoncé 4 à 5 fois à effectuer un déplacement du quotidien au cours des 5 dernières années. 21% des personnes ont renoncé plus de 5 fois à effectuer un déplacement du quotidien.
Les conséquences sont importantes dans l’accès aux droits, la citoyenneté, la santé ou encore l’emploi (on considère qu’un français sur 4 a déjà renoncé à un emploi faute de moyen de déplacement). - Ces renoncements touchent les plus précaires : 76% des 18-25 ans reconnaissent n’avoir pas pu accéder à un emploi ou une formation, faute de pouvoir s’y rendre, par manque de moyens personnels ou de transport en commun pour se déplacer, selon le baromètre annuel 2024 des apprentis d’Auteuil, en France.
En 2017, selon l’Insee, en France, les 10 % de ménages les plus modestes consacraient 21 % de leur revenu disponible aux transports (faisant des transport leur principal poste de dépense), contre 11 % pour les 10 % les plus aisés.
Environ 85 % des microcrédits accordés avec le soutien du Secours Catholique, à des ménages en situation de précarité sont en lien avec la mobilité. - Ces difficultés entraînent un vif sentiment d’injustice et d’exclusion de la transition écologique et par extension du pacte social. Selon le laboratoire des mobilités inclusives, plus le temps passé en voiture est long, plus le vote pour la candidate du Rassemblement National croît (34 % pour ceux qui sont moins de 30 minutes par jour dans leur automobile, 43 % entre 30 et 59 minutes, 42 % entre 1 et 2 heures et 49 % pour plus de 2 heures).
Dans ce cadre, le vélo peut constituer une partie de la solution, à différentes échelles :
- Pour rapprocher une partie de la population des transports en commun, favoriser l’intermodalité et ainsi diminuer la dépendance à la voiture.
- Pour contribuer à diminuer les budgets dédiés aux déplacements : l’Ademe considère que le coût annuel en moyenne de la voiture citadine thermique est de 4 800€, de la citadine électrique de 4 640€, des transports en commun de 310€ (abonnement) par an et du vélo de 96€ par an (hors achat). Même en couplant vélo et transports en commun, le budget est près de 12 fois moins important que se déplacer en voiture thermique.
- Pour que chacune et chacun puisse se sentir partie prenante des actions individuelles pouvant contribuer à l’effort collectif autour de la transition écologique.
FOCUS GENRE ET VELO
Une pratique inégale chez les femmes
La part modale du vélo est de 1.5% chez les femmes contre 4% en 2019 (Insee)
35% des cyclistes du quotidien sont des femmes (Ademe, Impact-economique-et-potentiel-de-developpement-des-usages-du-velo-en-france-en-2020).
Des freins spécifiques
Cette disparité de pratique s’explique par plusieurs facteurs liés à des inégalités structurelles et sociétales :
- Le rapport à l’espace public et la nécessaire sécurisation
Des inégalités sociétales dans le rapport à l’espace publique se traduisent par un rapport différent, notamment au danger, à l’utilisation de l’espace public, au fait de prendre sa place à vélo dans la rue qui affecte la mobilité des femmes et notamment la mobilité à vélo.
Ces éléments se vérifient dans les résultats du Baromètre Vélo de la FUB. Les réponses au baromètre 2021 montrent que les femmes sont plus nombreuses à juger le vélo dangereux en milieu urbain. Les infrastructures protégées augmentent la pratique féminine.
On les retrouve également dans l’étude réalisée par Bruxelles Mobilité et Pro Vélo Bruxelles (Être femme et cycliste dans les rues de Bruxelles. 2019) :
Les femmes ressentent plus fortement l’insécurité à vélo : 62 % des femmes considèrent que circuler à vélo en ville est dangereux, contre 47 % des hommes.
Elles signalent trois principaux obstacles :
– Rouler dans les couloirs de bus (où elles se sentent vulnérables face aux bus et taxis).
– Le trafic dense et les comportements agressifs des automobilistes.
– L’insécurité dans l’espace public, notamment le harcèlement (en journée et surtout la nuit).
Dans les rues où des pistes cyclables sécurisées ont été installées, la part des femmes à vélo a augmenté de 35 % en quelques années.
L’espace public est dessiné par des urbaniste, des services voiries de collectivités, parfois accompagnés des commission aménagements des associations représentatives des usagères et usagers : tous ces métiers et espaces sont encore majoritairement masculins, ne facilitant pas la prise en compte des besoins et spécificités propres aux femmes.
- Un apprentissage différencié selon les femmes et les hommes dans la société
Cela s’explique par une transmission intra-familiale qui se fait plus facilement vers les garçons que les filles, ou dans des espaces différents (témoignages d’apprentissage des filles sur le balcon ou la terrasse quand l’apprentissage du petit garçon se fait sur le parking à proximité du logement).
Les demandes de sécurisation par les femmes pour pratiquer le vélo s’expliquent également par les pratiques d’éducation différenciées dès le plus jeune âge. Les garçons développent ainsi un rapport plus normalisé au risque, tandis que les filles ont plus de freins psychologiques face aux situations perçues comme dangereuses.
La pratique du vélo est parfois aussi corrélée à la vélonomie, l’autonomie dans l’entretien et la réparation de son vélo. Or, la mécanique quelle qu’elle soit, est moins investie par les femmes et moins transmise aux femmes : il s’agit d’un secteur très genré.
- Chaîne des déplacements plus complexe
Les déplacements des femmes sont moins linéaires et pus fragmenté que ceux des hommes en raison de la répartition des tâches domestiques :
- 65% des femmes contre 49% des hommes réalisent des trajets avec de multiples arrêts (écoles, courses, etc) selon l’Enquête mobilité des personnes – 2019 – SDES.
- Les femmes réalisent 20% de trajets en plus, mais sur des distances plus courtes que les hommes qui réalisent 30% de distance en plus par jour (Insee, les femmes et la mobilité, 2021).
Ces inégalités impactent les déplacements à vélo, en raison des équipements spéciaux nécessaires sur les vélos, voire des vélos spéciaux (vélos familiaux), voire de l’inadéquation du vélo au-delà d’un certain nombre de personnes ou de poids à transporter. L’étude « Femmes et mobilités urbaines » réalisée en 2018 à Bordeaux par Yves Raibaud souligne ainsi les différences d’équipements des vélos selon le genre du cycliste, entre autres éléments d’inégalités.
Ces trajets nécessitent également des aménagements sécurisés : on est moins sujet à emprunter des trajets non sécurisés avec que sans enfants. Cela suppose que les destinations pour ces trajets (écoles, crèches, ephad, supermarché, etc) aient été identifiés par les aménageurs comme structurant pour le développement de la pratique des femmes.
FOCUS QUARTIERS POLITIQUES DE LA VILLE
La situation des Quartiers Politiques de la ville (QPV) – Extraits du rapport 2023 du Club des villes et territoires cyclables et de l’ANCT « A pied et à vélo dans les quartiers prioritaires. https://anct-site-prod.s3.fr-par.scw.cloud/s3fs-public/2024-04/guide-a-pied-et-a-velo-dans-les-quartiers-prioritaires.pdf
« Les habitants des QPV réalisent 10 % de déplacements en moins que ceux hors QPV.
Ils parcourent des distances plus courtes : Environ 15 km en 1h10, contre 26 km hors QPV (dans les unités urbaines de 50 000 à 199 000 hab.).
Un accès réduit à l’automobile : 44,6 % des ménages en QPV n’ont pas de voiture, contre 18,5 % hors QPV. La part des personnes sans permis est 2,25 à 3 fois plus élevée que hors QPV.
La part modale du vélo dans les QPV est de. 1,9% contre 2,8% pour l’ensemble du territoire national. Ministère de la Transition Ecologique, « Enquête Mobilité des Personnes 2019 », 2021.
L’usage restreint s’observe aussi à travers l’équipement des ménages : 83,6% des ménages vivant en QPV ne possèdent pas de vélo contre 66,8% hors QPV. En moyenne, les ménages possèdent 0,2 vélo contre 0,6 hors QPV. En revanche, ceux qui possèdent un vélo circulent beaucoup plus que la moyenne : 20,6% des utilisateurs ont un usage quotidien ou presque, contre 7,9% hors QPV.
Le vélo outil de travail : Une étude publiée en 2022 souligne qu’au 1er janvier 2022, parmi les 179 200 livreurs en activité en France, un sur quatre (24%) réside dans un QPV. L’image du cycliste en QPV est donc souvent associée à une activité professionnelle précaire. H.Botton, 2022, « L’ubérisation des quartiers populaires »
Le genre influence davantage la pratique des mobilités actives dans les QPV. Le taux d’immobilité des femmes est en effet supérieur de 7 points, comparé à celui des hommes résidant en QPV, et de 4 points comparé aux femmes résidant hors QPV.
La situation géographique des quartiers confronte les habitant·es à un enclavement lié aux coupures urbaines linéaires. Près de 90% des QPV sont concernés par au moins une coupure2 provoquée par le tracé des voies routières, ferroviaires, fluviales ou par des zones industrielles ou commerciales.
La part de logements collectifs et sociaux est très importante dans ces quartiers (94,1% de ces logements sociaux dans les QPV sont des logements collectifs) et les espaces destinés ne sont pas toujours sécurisés ou pratiques. »
En Pays de la Loire, les Quartiers prioritaires sont répartis de manière inégale sur les territoires :
- 3 dans le 53, à Laval
- 8 dans le 72, dont 5 au Mans et 2 à Sablé sur Sarthe.
- 15 dans le 49, répartis entre Angers et Cholet
- 19 dans le 44 (14 à Nantes, 3 à Saint Nazaire, 1 à Chateaubriant)
- 4 dans le 85, répartis entre la Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte.
2. Agir contre les inégalités liées à la mobilité
Les associations vélos constituent alors une ressource vers laquelle se tourner pour les personnes en situation de précarité .
Les vélo-écoles accompagnent ainsi vers l’autonomie à vélo des personnes souvent en parcours d’insertion, migrantes, liée à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), etc. Tandis que les bourses aux vélos et ateliers d’autoréparations permettent l’acquisition et l’entretien du vélo pour un faible coût.
ZOOM SUR LE PROGRAMME VELO EGAUX
Le programme Vélo-Égaux accompagne les personnes en situation de précarité en agissant sur 3 leviers essentiels pour rendre le choix du vélo possible : l’apprentissage de la conduite à vélo et l’aide, l’initiation à la mécanique vélo & l’acquisition d’un vélo.
Ce programme national est déployé dans 20 territoires, dont 4 en Pays de la Loire:
– La Solid à Clisson ( 44 ) contact : veloegaux@lasolid.fr
– Le Centre Vélo à la Roche Sur Yon ( 85 ) contact : veloegaux85@gmail.com
– Afodil à Angers ( 49 ) : j.belliard@afodil.fr
– la Sonette à Redon (35 ) : mathilde@lasonnette.org
Si votre structure accompagne des personnes en situation de précarité, à la recherche de solution de mobilité, n’hésitez pas à contacter directement ces structures.
Pour plus d’infos et de détail sur ce programme
ZOOM A VENIR SUR LA QUESTION DE LA RELOCALISATION DES DESTINATIONS